|
17 heures. Extérieur, nuit.
Je suis dans ma voiture, au pied de l’immeuble.
Je rêve en écoutant « Odjenar » de Miles Davis, sorte d’interrogation lente et hésitante, petites phrases ténues comme un secret, qui accompagnent les premières lumières de la rue....
Tu ouvres brusquement la portière, tu t’assieds auprès de moi et tu dis simplement : « c’est moi, Leila ». Je me suis tourné vers toi, tu t’es tournée vers moi. Nos regards se sont accrochés, longuement.
J’ai béni la nuit noire qui nous enveloppait et nous dérobait à la vie du dehors. Et j’ai plongé dans tes yeux, Leila.
Dérives et délices, Tu m’accueilles enfin sur la route de l’oubli ! J’ai donc su traverser la fragile certitude de l’apparence ?
Dans l’océan de la nuit, je suis au milieu d’un banc de poissons célestes :
Des milliards et des milliards, et tous, nous nous connaissons !
Je suis un cœur universel, relié à tous les cœurs universels.
Ensemble, nous nous connaissons, ensemble, nous Te connaissons.
Je vois et je sens par la vue et la pensée de notre cœur unique.
Cette nuit sidérale n’est que lumière et musique.
Elle est comme le manteau sans fin ni commencement, sans limites, qui englobe nos êtres unis en Un seul.
Parfois, Tu te fais voir séparé, quoi que sortant de nos pensées et de nos coeurs.
Tu te divises instantanément en myriades de particules lumineuses qui retombent sur nous et en nous.
Et tout recommence ainsi, infiniment, pour vivifier notre amour et notre volonté, juste pour décider : Création !
Arbre : je sens, dans la terre meuble, pousser mes racines, mes branches et mes feuilles.
Rocher : je sens surgir en moi cette poussée minérale qui me fait montagne.
Ruisseau : je deviens rivière, lac, mer immense.
Nuage : je vole, je file, je ris, je grandis ;
Il pleut sur ton visage, Leila, je suis tes larmes et celui qui les essuie.
Je suis le prisonnier et le remord, le don et le regret, le vivant, émouvant et imparfait.
Je suis malade. Je meurs heureux.
23 heures. Intérieur : boîte de nuit
Je suis enfermé, seul. La sono vomit une musique à un seul temps, horrible : les oreilles arrachées. Je suis seul : pourquoi m’as-Tu abandonné ? Comment, si bas, insignifiant à moi-même et aux autres ? Comment sans mobile et sans but ? Comment si las, si triste sans larmes. Une jeune fille danse, visage de Botticelli, longs cheveux blonds. Un jeune homme pâle et brun est avec elle : pas une lueur d’espoir sur leurs visages absents dans les sons atrocement présents. Je sors.
Deux heures du matin. Extérieur nuit : pluie dans la rue.
Je marche transpercé de pluie noire. Je suis en ban-lieu. Pas une vitrine. Sur les murs, l’horrible béton gris de ma déréliction. Au coeur de la poitrine, la nausée d’incertitude des rares lampadaires.
Je rejoins ma voiture. Je roule dans des rues inconnues, brillantes de pluie sale. J’allume la radio. Ma souffrance est comme la musique d’Enesco que j’entends : stridence de soprano, vacarme d’orgue. Ma souffrance est contenue dans ces rubans sonores, dont les couleurs entremêlées font surgir un horrible gris à peine éclairé d’éclats rouge sang.
Seule la musique me maintient en vie. Mort je serais, aspiré de néant, sans elle.
Andantino du concerto pour piano N°9 de Mozart : longue phrase du piano qui ne s’arrête jamais, et continue jusqu’à l’expiration. Sanglot des trilles : en réponse, tendresse du phrasé de la main gauche.
Chaque note me retient à la vie, chacune est comme déposée sur les petites ampoules allumées de l’éclairage de Noël de ce village inconnu, où je roule au hasard.
Six heures du matin. Extérieur nuit : route de campagne.
J’ai perdu les clefs de ma maison. Je ne rentrerai pas. Au jugé, je roule au nord, vers l’aéroport.
Je vais prendre l’avion. Je ne suis pas sur l’autoroute mais sur une route de campagne.
La pluie tombe toujours en rideau éclairé par les phares.
La musique du concerto, sur ce rideau, me désigne nos passions humaines : les personnages qui butent, se renversent, mêlent leurs douleurs, les soupirs, l’espoir, la suspension des phrases...
L’âme est l’héroïne du concerto, elle est dans le chant du piano : elle se meurt devant moi, blessée à mort. Puis elle se relève pour dire encore : je suis là, je t’aime toujours, mais je m’en vais.
Expiration finale, accords de fin.
Sept heures du matin. Intérieur : café de village.
J’entre dans ce petit café d’un autre âge : vieille maison, trois marches pour pousser la porte à carillon. Pas de musique. Les gens parlent à voix basse. Je demande un café, nous sommes plusieurs ainsi debout au comptoir. Des hommes du village, certains âgés, la casquette sur les cheveux bien peignés. Des jeunes en costumes et pardessus, prêts à prendre le train ou la voiture pour aller au bureau. Deux femmes emmitouflées dans les pulls chauds qui ont remplacé la chaleur douillette du lit qu’elles viennent de quitter.
Je bois mon café en silence, j’écoute les murmures ponctués d’exclamations, les bruits de la machine à café. Je paie et je sors.
Huit heures du matin. Extérieur (encore) nuit : la route.
Il pleut toujours. Je monte dans la voiture, je ne mets pas de musique. Plusieurs airs chantés me viennent spontanément en tête : voix suppliantes, voix tranquilles, vocalises, voix de femmes et d’hommes...
Lorsque j’approche de l’aéroport, le jour se lève. Aucun soleil : il pleut toujours. Lumière blafarde, lumière faible d’un petit matin froid.
Le soleil ne viendra pas du dehors. C’est au-dedans qu’il apparaît. Je sens, imperceptiblement, mais avec constance, les muscles de mon visage commander mon sourire. Je sens, dans mon corps, une chaleur bienfaisante qui afflue. Au moment où il cesse de pleuvoir, enfin, mes larmes coulent.
Et je dis MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI, MERCI. Fais de moi ce que Tu voudras.
|


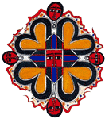




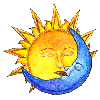

 La nuit la plus longue
La nuit la plus longue
